« La connaissance de la vie est plus importante que la connaissance des techniques d’écriture »
Scénariste depuis une trentaine d’années et multirécompensé, Michel Gaztambide a travaillé avec des cinéastes allant de Enrique Urbizu (Box 507, Pas de répits pour les salauds et Libertad) à Victor Erice (Fermer les yeux), en passant par Jaime Rosales, Julio Medem, Jaume Balguero… Il participe également à l’écriture de plusieurs séries (Gigantes). Autodidacte et enseignant, avec une attirance pour le genre policier, il nous parle de son approche du scénario et revient sur son parcours.
Un entretien mené par Jamal Belmahi, scénariste membre du SCA.
Jamal Belmahi : Avant d’évoquer ton parcours et ta pratique de l’écriture, peux-tu nous dire quelques mots sur la situation des scénaristes en Espagne ?
Michel Gaztambide : Aujourd’hui, je constate que la situation a changé et que beaucoup de jeunes veulent se consacrer à l’écriture. Je raconte souvent à mes étudiants qu’il n’y a encore pas si longtemps, les parents étaient très inquiets lorsqu’ils apprenaient que leurs enfants pensaient à devenir scénaristes. Aujourd’hui, avec notamment le succès des séries espagnoles dans le pays et à l’étranger, c’est devenu un métier plus respectable. On n’est plus obligé de vivre à Madrid pour vivre de son métier. On est quelques-uns à pouvoir vivre loin du « bruit et des on-dit » du métier. Moi, je vis à San Sebastian.
JB : C’est donc plutôt une bonne période pour les scénaristes espagnols ?
MG : Si je compare au passé, oui. Il y a d’une manière générale plus de travail pour tous les techniciens grâce aux séries, mais également parce qu’il y a de plus en plus de longs-métrages produits. Comme je considère mon métier de scénariste plus proche de celui des techniciens que des artistes, -je suis un scénariste de ce genre-là ! -, il existe également pour les scénaristes plus d’opportunités que dans le passé. Pour autant, personne ne comprendrait en Espagne que les scénaristes se mettent en grève. Ceux qui travaillent dans le cinéma sont tout de même encore perçus comme des gens gâtés, un peu fainéants et qui sont en plus relativement bien payés. Si en plus, ils décident d’aller dans la rue et revendiquer une amélioration de leurs conditions, personne ne comprendrait.
JB : Évoquons à présent ta filmographie qui commence à la fin des années 80. Peux-tu nous parler de tes débuts, comment es-tu venu à écrire des scénarios ?
MG : A ce moment-là, il n’y avait pas réellement d’école de cinéma et donc de formation de scénaristes. Il y en avait une célèbre au temps de Franco qui a formé de grands réalisateurs comme Carlos Saura et Victor Erice et quelques scénaristes qui nous ont montré le chemin. A la fin des années 70, l’école s’arrête. Il fallait alors pour apprendre son métier soit aller à l’étranger, soit se former sur le tas, en tentant sa chance. C’était le cas pour certains écrivains et j’étais l’un d’entre eux. J’écrivais alors de la poésie. Je trouve d’ailleurs que de tous les genres littéraires, la poésie est la plus proche de l’écriture cinématographique. Elle convoque en effet les images, le montage et ce qu’on peut appeler la verticalité du texte. Je me considère vraiment comme un autodidacte qui a surtout appris par ses erreurs. J’ai co-écrit trois films de suite, le plus important étant Vacas (Vaches) co-écrit avec Julio Medem qui l’a réalisé (1992). Ce film a beaucoup fait parler de lui pour ses partis pris de mise en scène, mais pas vraiment pour le scénario. Je n’ai donc pas eu de propositions de cinéma après sa sortie. J’ai eu une opportunité de travailler pour la télé et je l’ai saisie. Ce n’était pas de la fiction, mais des émissions de flux pour la télévision basque surtout, mais aussi parfois pour les chaînes nationales. Cette période a duré 9 ans. Puis je me suis remis à écrire un scénario La vida mancha (La vie salie) que j’ai fait lire à un ami réalisateur, Enrique Urbizu. A ce moment-là, il écrivait La caja 507 (Box 507). Comme il a beaucoup apprécié mon scénario, il m’a proposé de travailler sur son projet. J’étais ravi, car c’était un polar et que j’ai toujours aimé ce genre. Je n’ai donc pas hésité à quitter mon job à la télé pour me remettre à l’écriture avec Enrique. La sortie du film fut un petit succès commercial et on a reçu aussi plusieurs prix au Festival du film policier de Cognac (2003). On a alors enchaîné sur mon projet qu’Enrique a réalisé et qui est sorti un an plus tard. Depuis, je travaille sur des projets de cinéma surtout et depuis 2015, également pour des mini-séries.

JB : Cela représente quoi pour toi d’être autodidacte ?
MG : Pour moi, la connaissance de la vie est plus importante que la connaissance des techniques d’écriture. La règle des trois actes qui est comme une obsession pour beaucoup de monde me fait très peur. Son aspect dogmatique. A mes étudiants, je leur conseille vraiment de ne pas y penser surtout pour les premières versions d’un texte. Comme j’ai le syndrome de l’autodidacte, j’ai lu les manuels de dramaturgie américains pour que mes étudiants ne découvrent pas mon ignorance. J’ai été un moment troublé par ces livres, car je constatais que je n’écrivais pas du tout comme ils conseillaient de le faire. Heureusement, je suis tombé un jour sur un manuel de Jean-Claude Carrière qui m’a réconcilié avec les ouvrages de dramaturgie. Je devais un jour modérer une discussion entre Guillermo Arriaga et Jean-Claude Carrière. Ce dernier s’est excusé au dernier moment et n’a pas pu faire le voyage à Bilbao, mais pour moi, ces deux scénaristes représentent deux manières opposées de voir notre métier. Pour Guillermo, le plus important, c’est le scénario et le scénariste. Pour Jean-Claude, le scénariste travaille pour aider le metteur en scène à faire son film. Moi, je suis totalement dans cette approche que je compare souvent aux expéditions en montagne ou dans la jungle. Il y a l’explorateur en chef qui est le metteur en scène, puis autour de lui, des postes de confiance. Le scénariste, c’est le poste de confiance le plus important au début de l’expédition.
JB : Je n’ai pas oublié ta phrase sur le scénariste technicien et je reviens donc dessus.
MG : Bien sûr qu’il est aussi créatif, artiste.
JB : Et avec le réalisateur et le compositeur, l’un des auteurs du film.
MG : C’est vrai que l’on signe le scénario, que le metteur en scène attend de nous une sensibilité, un regard sur le monde, mais moi je n’oublie pas que je livre du papier et je reçois des images. J’ai donc l’impression de recevoir beaucoup plus que ce que je ne donne. C’est peut-être une modestie exagérée de ma part, mais j’ai vraiment l’impression que notre part du gâteau est moins importante que celle du metteur en scène.
JB : Quelle place prend justement pour toi la mise en scène dans ton approche de l’écriture ?
MG : Pour moi, c’est très important de penser aux images, de penser comment elles racontent l’histoire, mais aussi comment elles vont exister dans la tête des spectateurs. Il faut pour cela bien connaître les œuvres du metteur en scène ou si c’est un premier film bien comprendre ses désirs et les risques de mise en scène qu’il veut prendre. Il faut aussi toujours revenir à nos classiques, c’est-à-dire les films muets. Revoir, comme ils racontaient avec les images. Penser la mise en scène, c’est aussi penser le montage, penser les coupures, les ellipses. C’est pour ça que je n’aime pas la phase de travail sur le traitement, car je ne vois pas le montage, donc le film. Je commence à le voir à l’étape du scénario, lorsque j’écris des scènes. C’est là où je commence à sentir la chorégraphie des personnages, à sentir comment ils occupent et bougent dans l’espace, comment ils interagissent entre eux, comment le temps agit sur eux et aussi comment ils se comportent dans le 360° du lieu autour d’eux.
JB : Peux-tu développer cette dernière idée ?
MG : Beaucoup de jeunes auteurs, lorsqu’ils débutent, écrivent comme si la réalité d’un personnage au cinéma était limitée au 180° du théâtre. Ils ne pensent qu’à ce qu’il se passe devant la caméra, mais la réalité des personnages ne s’arrête pas à cet espace. Si on prend par exemple, deux personnages qui discutent sur un banc, on peut se contenter d’écrire un échange de dialogues devant la caméra. Si par contre, on prend en compte tout ce qui les entoure, ce qu’ils peuvent voir, un nuage qui passe, quelqu’un qui fait une chute, cela peut enrichir la scène. J’ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs qui donnaient de l’importance au 360°. Pendant qu’une scène se prépare, Enrique Urbizu aime par exemple prendre la place des comédiens pour voir ce qu’ils vont ou peuvent voir. Cela peut donner des idées qui n’étaient pas prévues par le scénario. De prendre en compte le 360° n’est pas la chose la plus importante pour un scénariste, mais en tant qu’autodidacte, j’aime me servir de choses qui ne sont pas évoquées dans les livres. Je donne également une grande importance aux détails. Ils permettent de donner plusieurs couches que les spectateurs ne découvrent pas forcément à la première vision et permettent différentes interprétations.
JB : Les détails, c’est aussi tenir compte des objets ?
MG : Dans Fermer les yeux de Victor Erice (2023), les objets sont très importants en effet. Ils évoquent la mémoire bien sûr, mais aussi le futur et le présent. Un billet de train, c’est le futur. Un vieux billet de train, c’est le passé. Le guichet de la gare, c’est le présent. Chez Kieslowski, un réalisateur que j’aime beaucoup, les détails sont très importants. Ce sont des objets ou des rencontres, des mini-évènements qui te permettent d’être plus proche de la vie, de saisir des états d’âme, de sentir ce qui pourrait arriver, de provoquer l’émotion. Pour cela, pas besoin d’un titre universitaire, même si de plus en plus de scénaristes ont aujourd’hui un diplôme. Heureusement, il y a encore des guerriers qui y arrivent en faisant des films magnifiques avec leurs copains, loin des grandes villes et des théories.

JB : Puisque tu cites comme exemple ta co-écriture avec Erice, était-ce un choix commun d’accorder tant d’importance aux objets ?
MG : Lorsque Victor est venu vers moi, il avait déjà un traitement de 30 pages avec un déroulement de l’histoire très clair. Il y avait trois temporalités : les années 70, les années 90 avec le tournage et la disparition de l’acteur, puis 2012 avec l’enquête. Une première décision a été de ne pas raconter le passé en images, à l’exception des scènes du film. Il fallait donc le raconter différemment. Victor avait déjà introduit plusieurs objets pour raconter l’évolution des personnages comme la photo de la chinoise par exemple, puis d’autres sont apparus lors de l’écriture commune des versions du scénario. Les spectateurs comprennent très bien cet attachement aux objets, leur charge émotionnelle. Dernièrement, il y a eu un grand incendie à Valence. C’était frappant de voir que les rescapés étaient désespérés d’avoir perdu tous leurs objets et surtout leurs photos.
JB : Tu as évoqué l’importance de penser la mise en scène à l’écriture, qu’en est-il de ton approche des personnages ?
MG : J’essaie toujours de trouver un élément du personnage qui vient de ma vie. Pas nécessairement que j’ai vécu, car ma vie n’est pas si intéressante que ça, mais qui a contribué à faire de ma vie ce qu’elle est. Quelque chose qui vient de mes parents, ma famille, mes amis ou même de personnages de fiction qui m’ont marqué. Je cherche quelque chose de très particulier qui me permet de sentir qu’un aspect du personnage est vrai. Pour que je sente son existence, je dois lui donner une voix que je connais, des cheveux de quelqu’un qui m’est proche, la manière de s’essuyer les mains de mon oncle, ... Si je n'y arrive pas, j’ai l’impression de rester extérieur à ce personnage.
JB : Accordes-tu beaucoup d’importance à la backstory des personnages ?
MG : Pour moi, le plus important dans un personnage, c’est qu’il me surprenne. Évidemment, il ne peut être complètement libre, mais j’aime lui accorder des moments de fuite, d’errance par rapport au récit. C’est souvent dans ces moments qu’il se révèle. J’aime accorder ces temps-là à mes personnages.
JB : Es-tu prêt pour autant à les suivre là où ils te mènent ?
MG : Oui, ça peut arriver.
JB : Même s’ils dévient du chemin que tu avais prévu pour eux ?
MG : Certains prétendent que tu dois connaître la fin de ton film avant de l’écrire. Je ne suis pas de cet avis. Par contre, comme Sidney Lumet, je pense qu’il est important de savoir avec quelle émotion tu veux que les spectateurs quittent la salle. Cette vision des choses te permet de donner plus de liberté aux personnages, de lâcher un peu la laisse.
JB : Et pour revenir à ma question, je devine donc que tu ne fais pas partie des scénaristes qui travaillent beaucoup la backstory de leurs personnages.
MG : Non, en effet, je dépasse rarement une page par personnage, contrairement à Victor Erice qui fait un gros travail en amont. J’aime par contre, dans certains films, évoquer le passé mystérieux d’un personnage sans pour autant l’expliquer, le révéler. Il y a actuellement une tendance très problématique à tout devoir expliquer. Or on le sait, les zones d’ombre sont aussi importantes que les zones de lumière. Dans la vie, on sent parfois que les personnes que l’on rencontre ont vécu des choses fortes, même si on ne sait rien sur eux. C’est ça qu’il faut arriver à faire sentir avec les personnages. Je ne sais pas beaucoup plus sur leur passé que les spectateurs.
JB : Tu as déjà dit que tu préférais nettement écrire une continuité dialoguée qu’un traitement. Qu’en est-il de la phase de la documentation, de la recherche ?
MG : J’aime beaucoup la phase du tout début, où il y a encore très peu de choses et que tu dois tout inventer, « remplir la valise » comme on dit. C’est un travail sur les archives, sur les images existantes, sur la recherche de lieux. J’essaye dans ces moments d’élargir mon imaginaire, de me sentir libre. C’est une période très plaisante pour moi, car je n’ai pas peur de me tromper.
JB : Nous avons évoqué ton travail avec Enrique Urbizu et Victor Erice. Peux-tu nous raconter ton expérience d’écriture avec Jaime Rosales sur le film Petra (2018) ?
MG : Jaime Rosales travaille d’une manière très particulière. Il écrit seul les premières versions du scénario, puis à un moment, on va dire à la V4, il m’envoie ce qu’il a fait. Je lui fais des retours, puis il me dit : « Vas-y, essaye ». J’écris une version, la V5, puis je lui envoie. Il se remet à travailler seul la V6, puis l’envoie à l’autre co-scénariste, Clara Roquet, qui fait également dans son coin une version. Ainsi de suite. Je n’avais jamais travaillé de cette manière. Jaime me l’avait annoncé avant même qu’il ne commence à écrire : nous serons trois sur le scénario. Je lui ai demandé pourquoi trois et pas deux ou quatre. Jaime, qui est quelqu’un de très cérébral, m’a répondu : ça sera trois. C’est le dispositif qu’il avait imaginé pour ce film. La seule chose qui me gênait, c’est qu’il n’intégrait pas mes dialogues dans ses versions. J’aime beaucoup écrire les dialogues, donc je ne comprenais pas. J’ai fini par lui demander s’il me trouvait si mauvais dialoguiste que ça. Il m’a alors confié qu’il réservait cette phase de l’écriture à son travail avec les comédiens.
JB : Existe-t-il une forme de co-écriture que tu préfères ?
MG : Il existe des réalisateurs qui n’aiment pas ou ne veulent pas écrire, je suis alors le seul scénariste. D’autres, comme Enrique ou Victor, sont de très bons scénaristes, mais ne veulent pas être seuls pendant l’écriture. Dans ces cas-là, je suis véritablement co-scénariste et on travaille ensemble sur le texte. On ne travaille pas forcément en même temps, mais on est sur le même document. C’est ce que je préfère.
JB : As-tu une routine d’écriture ?
MG : J’essaye en effet d’avoir une routine d’écrivain et d’écrire chaque jour. Des fois, j’écris une page, parfois quatre, mais j’ai vraiment besoin de le faire chaque jour de l’année. Les week-ends, je ne travaille pas.
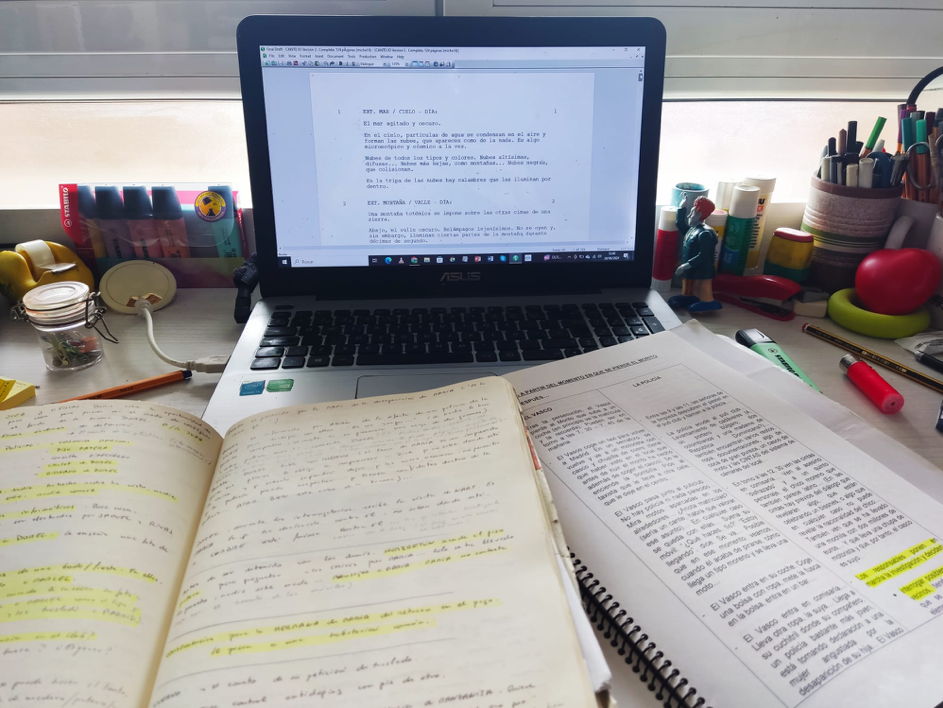
JB : Dans Fermer les yeux, Miguel, le personnage principal, tombe par hasard sur un de ses livres qu’il avait dédicacé à une femme. Cet incident le pousse à vouloir la retrouver. Quelle place donnes-tu au hasard ? Jusqu’à où te permets-tu d’aller ?
MG : Je l’évite évidemment dans les moments décisifs de l’histoire et d’une manière générale, j’essaye d’éviter qu’on sente l’intervention du scénariste dans le scénario. L’exemple que tu donnes avec la dédicace pourrait être de cet ordre, sauf qu’ici, il permet d’ouvrir une nouvelle porte dans le passé du personnage et de provoquer des émotions. Donc je trouve que dans ce cas, ça fonctionne et que c’est une belle idée de Victor.
JB : Dans Petra, il existe plusieurs retournements de situation très forts concernant la paternité du personnage principal. Est-ce que tu t’es posé la question de l’intervention du scénariste dans ce cas-là ?
MG : C’est un film sur les non-dits et les mensonges, donc j’ai joué le jeu. On est peut-être allé un peu loin, mais j’avais l’impression que ça pouvait marcher. Je vais le revoir, puisque tu poses la question.
JB : Je me suis juste dit en regardant le film "ils ont osé".
MG : Oser, c’est bien pour l’écriture de scénario. Parfois, on se trompe, mais ce n’est pas grave. Je parlais récemment avec des gens du Festival de Nantes qui trouvaient que le cinéma espagnol était très varié et original. Je pense justement que cette originalité est liée au fait d’oser, de dépasser certaines limites que l’on s’impose dans l’écriture.
JB : Le film Pas de répits pour les salauds (2011) que tu as co-écrit avec Enrique Urbizu est un bel exemple d’originalité, je pense notamment au changement de point de vue à la moitié du film.
MG : Oui, un critique nous l’avait d’ailleurs reproché. Dans la scène de la tuerie au début du film, on voit à travers des images de la caméra de surveillance que le personnage principal est observé par quelqu’un. Pour nous, ça suffisait à préparer le spectateur qu’un autre point de vue existait dans cette histoire.
JB : Est-ce que d’une manière générale la question du point de vue est importante pour toi ?
MG : Contrairement aux jeunes auteurs qui passent très facilement d’un point de vue à l’autre ou qui ne se posent souvent même pas la question, pour moi, elle est essentielle. Je l’ai appris avec les réalisateurs avec qui j’ai travaillé. Je me considère vraiment de la vieille école par rapport à ça. Dans le genre, le film policier notamment, la gestion des points de vue me parait fondamentale. Le prendre en compte veut dire aussi prendre au sérieux celui du spectateur. Dans Box 507, co-écrit avec Enrique Urbizu, on donne aux spectateurs dans les vingt premières minutes du film l’impression qu’il est dans un point de vue omniscient. Il a l’impression de tout voir, tout savoir. Puis à un moment, le personnage principal découvre des papiers et on suggère qu’ils contiennent des informations importantes. La caméra choisit à ce moment de ne pas en révéler le contenu. On entre alors dans le point de vue du personnage principal. Les spectateurs sentent que quelque chose a changé dans leur perception de l’histoire. Jouer avec le point de vue, c’est choisir ce qu’on éclaire ou à l’inverse où l’on souhaite mettre de l’ombre, du mystère.
JB : Le mot qui revient souvent dans tes réponses, c’est l’émotion.
MG : Évidemment. Pour moi, si tu veux avoir une carte d’identité de cinéaste, tu dois pouvoir provoquer l’émotion. Quand je dis cinéaste, je parle des metteurs en scène et des scénaristes. Si tu n’y arrives pas, tu peux arriver à travailler dans certaines séries, mais pas au cinéma.
JB : Une question d’un autre ordre : sur les projets sur lesquels tu travailles, combien sont produits ?
MG : Je dois être à 60 % et je me considère comme très chanceux par rapport à ça.
JB : Es-tu invité par les festivals ? Es-tu présent lors des sorties des films ?
MG : Pour moi, ça serait incommode d’être trop présents dans les festivals. Je n’aime pas quitter ma routine de travail et de vie tout simplement. De temps en temps, c’est bien, mais au final, personne ne sait trop quoi faire avec les scénaristes. Je ne parle même pas des tournages où clairement tu ne sais même pas où t’asseoir. La dernière fois, ils m’ont mis près de la mère d’un enfant comédien et on a échangé quelques banalités. Dans les festivals, c’est un peu la même chose. Le metteur en scène et les comédiens sont là pour défendre le film. Quelle est la place du scénariste à côté d’eux ? Comme Victor n’aime pas aller en festival, il m’a demandé d’aller à Cannes pour Fermer les yeux. C’était une première pour moi et j’ai découvert ce monde étrange. Il faut le vivre une fois, mais après je me suis vite senti mal à l’aise avec toutes ces questions de journalistes autour du film. J’avais l’impression d’usurper la place de Victor. Je pense que beaucoup de scénaristes préfèrent être dans l’ombre. Pas tous, je sais ! Ça serait très compliqué pour moi par exemple d’être une personne qu’on reconnaitrait dans la rue. J’aurais l’impression de ne plus pouvoir faire mon métier.
JB : As-tu le temps pour des projets personnels ?
MG : Non, je croule sous la commande.
JB : Et tu t’y retrouves complètement dans ce travail de commande ?
MG : Oui, tout à fait. Comme un technicien qui travaille, qui doit résoudre des problèmes… Et de temps en temps, j’écris de la poésie.
JB : Ah, quand même !
MG : Oui, et avec ça, je suis tranquille…
Entretien mené par Jamal Belmahi, scénariste membre du SCA, en mars 2024.
Merci de citer le SCA-Scénaristes de Cinéma Associés pour toute reproduction

