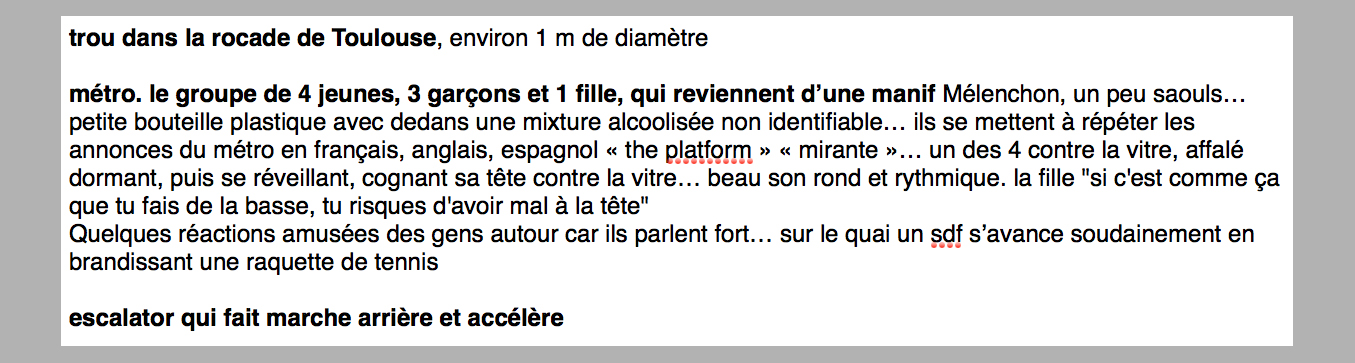Scénariste depuis une vingtaine d’années, Mariette Désert a travaillé avec des cinéastes allant de Mikhaël Hers (Memory Lane, Ce sentiment de l’été et Les Passagers de la nuit) à Katell Quillévéré (Un poison violent et Suzanne), en passant par Virgil Vernier, Wissam Charaf, Blaise Harrison… Autant de façons d’écrire et d'envisager un scénario que de partenaires aux univers singuliers dans le paysage du cinéma français. Dernièrement, elle a coécrit une mini-série avec et pour Erwan Le Duc, Le monde n’existe pas, en compétition française au festival Séries Mania et diffusée sur Arte à l’automne 2024.
Un entretien mené par Nadja Dumouchel, scénariste également membre du SCA.
Nadja Dumouchel : En tant que scénariste, qu’est-ce qui te fait vibrer dans l'écriture ? Est ce qu'il y a quelque chose, peut-être un détail, le moment où tu te mets sur l'écriture ou une étape de travail que tu aimes particulièrement ?
Mariette Désert : L’étape que je préfère, mais je pense que la plupart des scénaristes te diront ça, c’est le moment où tu sens que tout se met à faire écho et à fonctionner, il y a une sorte de moment de grâce parfois comme ça, qui est vertigineux. Après, c'est long l’écriture, et dans les petits plaisirs qui peuvent surgir, il y en a plein de trucs différents… Parfois juste des dialogues, des scénettes entraperçues, des lieux que tu utilises ou des rencontres que tu fais quand tu réfléchis au scénario, et qui tout à coup renversent les choses.
Mais sinon, pour parler plus particulièrement de la co-écriture, je crois que j’aime bien travailler avec quelqu'un parce que j’ai besoin d’être surprise par des idées auxquelles je n'aurais pas pensé. J’aime m’infiltrer dans des univers où il y a clairement une note qui résonne avec moi, quelque chose qui rejoint ma sensibilité, mais où il y a aussi des éléments et une matière qui ne sont pas à moi et qui me font du bien, qui me sortent de moi. Je pense que ça c'est très important.
Dans la pratique, je m’aperçois que je me retrouve assez souvent seule aux commandes d’une écriture ou d’une réécriture… Que ce soit juste pour une version avant d’entamer un ping pong avec la ou le cinéaste, ou que ce soit tout le long de l’écriture en l’ayant en vis à vis… Et j’aime vraiment bien ça. Mais j’ai l’intuition que je ne pourrais pas écrire seule de bout en bout sur un projet perso par exemple. J’aurais peur de m'ennuyer avec moi-même (rit). Je pense que si jamais je devais initier quelque chose, j'irais chercher au bout d’un moment un.e co-scénariste !
ND : Tu as co-écrit avec des cinéastes aux univers très différents, Mikhaël Hers, Katell Quillévéré, Virgil Vernier, Wissam Charaf… Peut-être que tu peux revenir un peu à tes débuts, comment tu as su que c’est ça que tu voulais faire ? Qu’est-ce qui t’a poussé, à l’époque, à tenter le concours de la Fémis ?
MD : En fait, j'ai commencé par faire de la biologie parce que je ne savais pas trop quoi faire et que la bio m'intéressait énormément, ça m'intéresse toujours beaucoup d’ailleurs. Je pense que c'était un peu pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne, ce n'est pas si loin des envies de scénario. Ça me passionnait ! Et notamment la botanique… Par exemple ces fleurs qui ressemblent à des insectes pour attirer les pollinisateurs... Si tu commences à t'intéresser au vivant, aux manières de fonctionner du vivant, tu découvres que le monde est fou… En tout cas, moi, je le trouve fou ! Mais en fait, très vite, j'ai vu que les métiers au bout, ils ne m'intéressaient pas. Et à un moment j'ai eu une crise de révélation désespérée (rit)… J'avais différentes pratiques artistiques à l’époque, j’étais sensible au cinéma mais c’était plutôt le monopole de ma sœur qui était fan de Hitchcock… Mais j’ai fini par me dire que le seul art qui réunit tous les autres, c'est le cinéma. Après, aujourd’hui, je pense que ce n’est pas complètement vrai, ce n'est pas ça le cinéma, mais à l’époque je me suis dit qu’il fallait absolument que je fasse ça du coup. Et là, comme j'étais en province et assez jeune, c'était compliqué. Je n'avais pas du tout de réseau ni quoi que ce soit. J'ai tenté une école sur Toulouse, l’ENSAV, mais je ne l'ai pas eue. Et Paris ça me semblait inaccessible. Le seul moyen d'aller à Paris pour faire du cinéma, pour moi, dans le cadre où j'étais, c'était de faire une école. Comme la Fémis c'était bac plus deux, je me suis réorientée en lettres avant de tenter le concours et je ne l’ai eu que du deuxième coup. Á l’époque, ma pratique était plutôt celle de l'écriture, j'écrivais des nouvelles, des choses comme ça, donc intuitivement, j'ai présenté en scénario.
ND : Tu connaissais déjà quelque chose au métier de scénariste avant de t'inscrire en scénario ? Parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir une conscience de ce qu'est le rôle du scénariste, à 19 ans.
MD : Si, je crois que je savais quand même vaguement. Sans idée super précise, mais je savais qu’il s’agissait d'imaginer l'histoire du film, de l'écrire soi-même ou de l'écrire avec quelqu'un d'autre. Mais je me suis sentie quand même un peu en décalage en entrant à la Fémis parce que je trouvais que la plupart des autres admis étaient hyper forts, ils connaissaient tout, ils avaient tout vu. Moi j’avais une petite base, grâce à quelques vhs, à la création de la chaîne Arte, et à une option cinéma que j’avais prise pour préparer la Fémis… Mais quand je suis arrivée dans l’école, je me suis rendue compte que je ne connaissais rien en fait, que j'étais une « bleue »... Même sur la nouvelle vague, je connaissais très peu de choses finalement. J’avais peut-être vu un Godard, un Truffaut et c’est tout…Du coup, j'ai passé trois, quatre ans à manger des films. Et là, j'ai pris des claques. J'ai découvert des manières de raconter que je n'aurais jamais imaginées. J'étais assez attirée par tous ceux qui ont essayé des dispositifs formels complètement inattendus, voire ludiques. De la drôlerie d’un Luc Moullet par exemple à un film assez méconnu et très audacieux dans sa forme : « L’homme qui ment » de Robbe-Grillet.
ND : Dans les dispositifs formels, qu'est ce qui t'a particulièrement marquée ?
MD : J'ai notamment découvert le documentaire ou tout ce qui pouvait jouer avec l'idée du documentaire. « La Commune » de Peter Watkins par exemple… « Chronique d’un été » de Jean Rouch. Jusque là, je n’avais même pas imaginé qu’un documentaire puisse être un film de cinéma, je ne connaissais que les documentaires télé ! Côté fiction, Bergman et tout Pasolini, la manière dont ils faisaient leurs films, ça m'avait vraiment impressionnée aussi. Ou ce qui sortait en salles, c'était la grande époque de Gus Van Sant, « Elephant » ou « Last Days », « Mulholland Drive » de Lynch aussi. C'était des films qui proposaient formellement des choses qui n'avaient jamais été vues jusque-là et qui me plaisaient beaucoup. C’était vraiment ça mes premières amours à la Fémis. Et donc je me suis retrouvée là, en écriture, en scénario, où je n'étais pas si mal, c'était une place qui m'intéressait. Après, ce qui est bien à la Fémis, c'est qu’on y fait des films, donc tu peux tester des choses… et te rater sans que ça ait trop de conséquences !
Dans ce qui était moins bien à la Fémis, à l'époque en tout cas, c’est que comme scénaristes, on se sentaient un peu délaissés. On co-écrivait sur quelques courts mais la majorité du temps, on écrivait dans notre coin… et seuls. Il n’y avait pas de travail collectif ni d’expériences en dehors de l’école. Aujourd'hui, ils font plus de choses à l'extérieur, je crois… Et ils sont plus ouverts aussi. Ils écrivent des séries par exemple. Nous, c’était très « auteur ». Il y avait une vague idéalisation de l'auteur-créateur et aussi un climat de compétition un peu pesants à mon goût. Il me semble que ça s'est un peu détendu… Enfin, j’espère !
ND : Aujourd’hui, le scénario a peut-être une place un peu différente dans l’école ?
MD : Oui, il est beaucoup plus valorisé à la Fémis qu’à mon époque parce que depuis, pas mal de personnes qui ont fait scénario sont devenues des cinéastes reconnus que ce soit Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski ou d’autres grâce au long-métrage qu’elles avaient écrit au sein de la Fémis... Nous, par exemple les travaux de fin d'études, en scénario, il n’y avait personne qui venait les écouter, ça n’intéressait vraiment personne. Et maintenant, la salle est remplie. Beaucoup de producteurs y vont parce que ça fait « les films de demain ». Donc nous, on se sentait un petit peu dévalorisés en scénario, mais bon, c'était quand même une expérience intéressante.
Après, moi, j’ai quitté la Fémis quelques mois avant la fin. Je n'ai pas passé mon diplôme car je ne me sentais plus bien dans ce cadre là pour plein de raisons différentes qui seraient trop longues à expliquer. Mais de toutes façons, une fois sortie, ton diplôme on ne te le demande jamais. Et l’important, c’est l’expérience accumulée au sein de la Fémis et les rencontres que tu y fais. Et en ce sens, c’était une vraie chance d’avoir pu intégrer cette école.
ND : Et du coup, quelle est la famille que tu t’es trouvée, toi, à la Fémis ?
MD : Dans ma promotion il y avait Martin Rit, en image, avec qui j’ai co-écrit deux courts métrages dont l’un, « La leçon de guitare », a eu un succès assez dingue, ce qui a permis que je sois très vite « identifiée ». Le producteur de ce court, et qui était dans la même promotion que moi à la Fémis, c’était… Mikhaël Hers avec qui j’ai travaillé par la suite. De manière plus indirecte, il y avait aussi en section production Jean-Christophe Reymond qui m’a fait rencontrer par la suite Virgil Vernier. Il y a eu également un intervenant extérieur qui m’a demandé de travailler sur son projet… des choses comme ça.
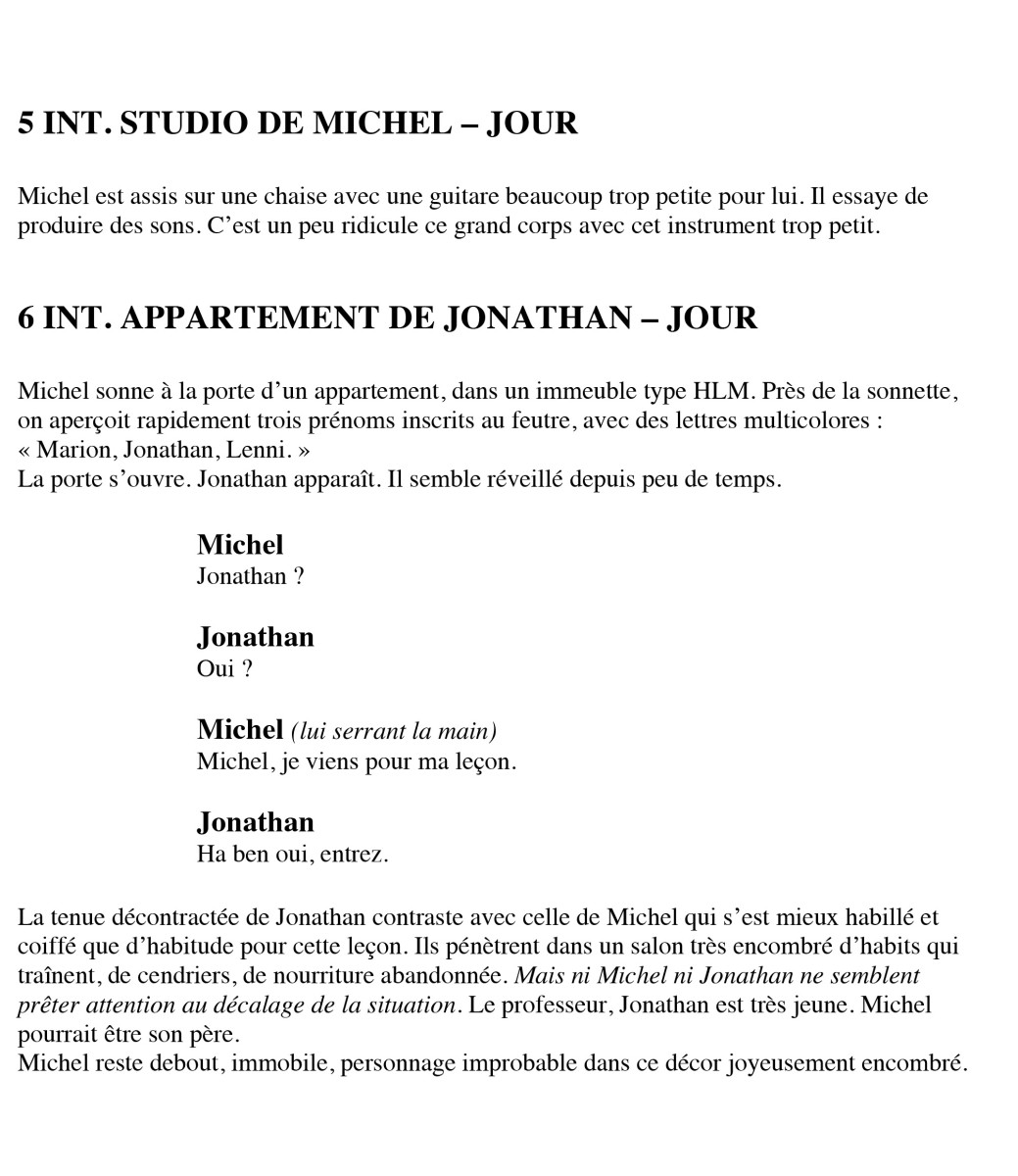
MD : C'était « Charell ». C'était son premier moyen métrage en dehors de l’école. Il était adapté d'une nouvelle de Patrick Modiano. Il y a des choses très belles dans le film, mais selon moi, à ce moment-là, Mikhaël était encore en train de chercher son cinéma, de chercher sa forme. Pour moi, son cinéma se révèle quand il a fait « Primrose Hill », que j’aime énormément… Et là, tout le cinéma de Mikhaël est là d’un coup, avec une évidence incroyable.
ND : Et quel est l'endroit où toi et Mikhaël vous vous retrouvez dans l'écriture ? Qu'est- ce qui correspond à ton style, dans son cinéma ?
MD : Avec Mikhaël, il y a vraiment plein de choses. Dans ses films, il travaille le temps, et il travaille comment la vie agit sur nous, en bien ou en mal… La part de mystère et d’inattendu qu’elle recèle aussi. C’est-à-dire que dans les films de Mikhaël, c'est rarement des conflits entre les personnages qui sont au centre. Ce qui empêche, ce qui crée les obstacles souvent, c'est plutôt les deuils, les trucs de la vie, la violence qui rôde, c'est le fait de se séparer, comment on surmonte les choses ou pas… Cette matière-là. Pour lâcher un gros mot, je dirais que ce sont des films « existentiels »… Comment on fait avec la vie... C'est vraiment quelque chose, moi qui me touche énormément, qui me questionne et sur lequel on se retrouve. C'est quelqu'un aussi qui travaille toujours un territoire, qui écrit à partir d'un lieu. En fait, c'est aussi le cas pour Virgil Vernier, et pour d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, comme Blaise Harrison par exemple. Je pense que je suis extrêmement sensible à ça. Et j’aimais beaucoup également que ce soit sur des toutes petites choses que ça se joue avec Mikhaël. On n'est pas dans les gros conflits ou dans les gros rouages narratifs… Et en fait, sans que ça se remarque, c’est un vrai défi formel en soi, un vrai parti pris.
ND : La dramaturgie des petites choses…
MD : C’est ça. Où les choses se jouent aussi parfois en creux dans ce qui se passe, dans ce qu'on devine, dans ces textures-là. Où le réel et les personnages gardent une part de mystère tout en étant très incarnés. Je pense aussi que ce qui nous lie, c’est que tous les deux on a une matière commune dans ce qu’on a vécu, que ce soit avec nos amis, la famille ou dans ce qu'on perçoit du monde autour de nous. Et puis je suis très sensible à sa manière de filmer, une forme de musicalité et de lyrisme empreint de douceur.
ND : Comment tu décrirais cette réflexion sur le lieu dont tu parlais, ou le rôle que peut jouer un territoire dans un film, dans l'histoire ? Comment vous réfléchissez à ce lieu ? Est-ce que vous le traitez comme un personnage ? Peut-être tu peux commencer par le travail de Mikhaël Hers et parler ensuite du travail avec Virgil Vernier par exemple, qui a, lui, des lieux encore plus déterminés et précis.
MD : Oui, c’est assez différent chez les deux. Chez Mikhaël c’est plus un territoire sur lequel les vies se greffent, et comment tu déambules, comment tu habites ces lieux et comment ils sont porteurs de ce que tu as vécu, de ta mémoire... Il y a par exemple parfois des plans de lieux vides où on a vu les personnages passer. Et ça travaille en fait les traces, la question de ce qui reste de nos vies ou pas. Il y a le côté microcosme aussi… Par exemple un espace entre des immeubles, comme un petit théâtre, où on va suivre un groupe de personnes et où on en croise d'autres. C'est comme si ça donnait accès à tout un monde extérieur, à toutes ces vies qui nous frôlent et auxquelles on n’a pas accès. Après, ça peut nourrir des choses d'un point de vue sociologique. Dans « Memory Lane » c’était la banlieue sud-ouest de Paris, mais un milieu de classe moyenne un peu basse en fait, et cette notion d’être « à côté » de Paris, c’était vraiment important. Ça travaillait quelque chose dans le film, notamment ce sentiment d’avoir peur de passer « à côté » de sa vie. Pour moi l’ADN du cinéma de Mikhaël pourrait se condenser dans une scène où deux personnages se retrouvent et se demandent des nouvelles : « Comment vas-tu ? »… question à la fois anodine, et puissamment existentielle selon moi !
Chez Virgil Vernier c’est extrêmement différent, les lieux qu’il choisit sont des lieux qui posent des questions politiques et qui représentent pour lui un état du monde et de notre société, qu’il va questionner, critiquer. Les tours des Mercuriales, pour lui, c'était vraiment un symbole de nos sociétés capitalistes, une représentation de la puissance qui écrase et fascine en même temps. Il utilise la symbolique des lieux, c'est à dire de ces deux tours, en suivant deux filles qui travaillent là et qui vont se débattre avec les injonctions et les violences de la société. « Sophia Antipolis », c'est un peu le même principe. C’est le nom d’une technopole proche de Nice, créée dans les années 70 sur le modèle de la Silicon Valley. Virgil va animer plein de personnages qui sont en marge de ce lieu là et qui vont un peu le subir, ou par le biais desquels il va en montrer les maux, les symptômes.

MD : Il y a d’abord vraiment une base documentaire, il amène énormément de matière, et la plupart des personnages sont déjà là, et certaines scènes clés aussi. Après, c’était différent dans « Mercuriales » et « Sophia Antipolis ». Dans « Mercuriales », j'étais en écriture avec lui. Et dans « Sophia Antipolis », j'étais en collaboration. C'était des consultations ponctuelles à des moments clés.
Pour « Mercuriales », ça a été une écriture assez longue avec pas mal de modifications. De ce que je me rappelle, quand je suis arrivée, il y avait un synopsis assez précis mais inabouti où il y avait cette idée des tours des Mercuriales et de ces deux filles qui se rencontrent dans ce lieu et qui vont nouer une amitié très forte, un petit peu comme un rempart contre tout ce qui se délite dans leur vie, contre la violence subie donc et aussi la dépression qui guette. Et il y avait le moment où elles partent en Alsace, où elles fuient, comme une tentative d’autarcie. Mais après, tout restait à créer et à équilibrer. Il y a eu également assez vite le personnage d’un jeune garçon qui a mis du temps à trouver sa place et qui finalement sera plutôt développé dans « Sophia Antipolis ». Avec Virgil Vernier, ce qui était un peu particulier, c'est que comme c'est lui qui amenait énormément de matière, et qu’on ne se connaissait pas trop, au début, je n’intervenais pas directement dans le texte. C'était surtout des discussions ou alors je lui écrivais des scènes à côté, des dialogues, et il décidait de les insérer ou pas. Je ne mettais pas les mains dans le texte principal… sauf vers la fin où il me faisait un peu plus confiance. En parallèle, il va chercher de la matière un peu partout, beaucoup de recherches sur internet aussi. « Mercuriales », c'est vraiment vampirisé par des images du net, par des contes, des articles, des faits divers…
ND : On retrouve ces éléments dans le scénario ? Je me souviens de l’avoir lu pour Arte et m'être dit qu’il ne ressemblait pas du tout à un scénario classique !
MD : Oui, c’est vrai, ses scénarios sont assez atypiques dans leur forme. Il y a souvent des séquences écrites avec une grande précision et d’autres moments parfois plus ébauchés. Et il n'y a pas forcément de numérotation de séquences… ça dépend. Le scénario reflète vraiment le mouvement du film.
Mais en même temps c’est quand même très écrit et beaucoup plus précis qu'on ne le croit, par rapport à ce qui est finalement tourné… Même dans les dialogues. Après bien sûr, au tournage, et au montage, il continue de nourrir le film à partir des castings qu’il fait, et des éléments documentaires qu’il trouve.

MD : Alors là aussi, ça a pris du temps, mais je n’intervenais donc que ponctuellement. Je me rappelle que dès le début, il y avait ce personnage de la femme de 40 ans qui est toute seule et qui va intégrer une secte. Et puis le personnage du jeune garçon amorcé dans « Mercuriales », qui ici devient vigile puis intègre une milice des rues. Il y avait vraiment cette symétrie entre ces deux parcours, deux solitudes qui tentent d’intégrer un groupe… Et d’autres personnages en plus, mais qui ont disparu. Il y avait aussi cette idée de l'hypersexualisation comme modèle dominant de nos sociétés qui est une thématique qui travaille beaucoup le cinéma de Virgil. Comment nos sociétés aujourd’hui renvoient aux filles un idéal féminin très sexualisé, avec son lot de chirurgie esthétique, et aux garçons un modèle viriliste de gladiateur… ce genre d’injonctions qui vampirisent les personnages. Il y avait en germe cette idée d'une jeune fille assassinée mais ce n’était travaillé que par échos. Moi je trouvais que ça restait encore trop abstrait alors l’idée est venue d'incarner cette histoire là, qui a fini par structurer en fait tout le film, par un personnage qui a connu cette jeune fille qui est décédée, ce qui a donné la troisième partie. Cette idée par exemple vient de moi, mais le motif était là, à la base.
Dans « Mercuriales », et « Sophia Antipolis », Virgil filme le réel comme si c’était de la science fiction, une dystopie, un monde étrange qui va exploser… Ça donne une grande force à ses films, je trouve. Moi dans tout ça, je l’aide à structurer sa pensée, à structurer le scénario, à trouver et modeler des scènes et des dialogues et je suis là pour veiller à ce qu’on garde un accès aux personnages, même quand on a des personnages à priori un peu étranges, voire inquiétants, comme des miliciens de rue ou des adhérents d’une secte donc. Notre travail c'est essayer de comprendre le raisonnement de ces personnages-là et de montrer comment les maux de la société agissent sur eux. J’ai toujours pensé que chez Virgil, à la base, les personnages ont une forme de pureté, d’innocence, et que notre boulot c’est de montrer comment la société les dérègle… ou pas.
ND : Est-ce que tu as un exemple de co-écriture où tu travailles plus en mode ping-pong ?
MD : Oui, par exemple avec Katell Quillévéré sur « Suzanne » c'était vraiment moitié moitié depuis la première idée. Elle avait l’idée d’une fille qui est en prison, et son copain aussi. Il réussit à s’enfuir alors qu’elle reste en prison… Ce qui correspond presque à la fin du film actuel. Et moi j'avais très envie d'un film, qui me hantait depuis longtemps, soit l'histoire de deux sœurs, soit de deux amies, mais sur un temps long. On a cherché un territoire commun pour écrire ensemble et ça a donné « Suzanne ». Et là, c'était assez égal dans la répartition du travail. Avec Wissam Charaf, c’est assez ping-pong aussi. Il a toujours une base de version dialoguée mais inaboutie, d’environ 30-40 pages, avec des vrais trucs qui sont déjà là. Et à partir de là, moi j'amène toutes mes idées, toutes mes envies et on en parle. Je reprends le texte toute seule une première fois et puis, on fait des aller-retours.

ND : Et avec Mikhaël Hers, techniquement, comment vous travaillez ensemble ?
MD : Avec lui c’est un peu différent. Les deux premiers longs sur lesquels j’ai travaillé avec lui, (la dernière fois sur « Les passagers de la nuit », développé principalement avec Maud Ameline, c’était un autre cas de figure), il amène toujours une V1 dialoguée très nourrie et très longue ! Avant, on peut avoir discuté d’idées, de pistes, et puis tout à coup il disparaît et quelques mois après il revient avec un scénario… qui n’a souvent pas grand chose à voir avec ce dont on a discuté ! Même si souvent il y a des liens souterrains.
ND : La phase du traitement, vous l’ellipsez ?
MD : C'est ça. Mais en fait, je passe assez rarement par une phase de traitement avec les cinéastes avec qui je travaille. Parce que souvent ce sont des cinéastes qui ont besoin que le cinéma soit là tout de suite et quand ils ont une envie de film, ça passe directement par des scènes incarnées. Et, selon moi en tout cas, ils ont une manière d’incarner une scène qui ne ressemble à personne d’autre. Cette manière va conditionner la façon de raconter, de développer le récit. Donc en fait la base, c’est l'incarnation, c'est à dire comment ça va être filmé, comment ça va parler, quelle est la tonalité, le rapport aux personnages, où ça se joue... C'est presque plus important que l'histoire ou comment on va développer ça. Donc il y a des sortes de scènes ou de moments clés qui sont très incarnés. Et à partir de là, on peut développer un film.
ND : Pourtant souvent les producteurs demandent des traitements pour pouvoir déposer des demandes de subventions ?
MD : Après, on peut revenir à ce type de document. C'est à dire on travaille sur des documents où il y a déjà des dialogues, où on sent déjà la manière de faire les scènes et s’il y a besoin de financements, à partir de là on écrit un traitement plus règlementaire. Ça peut même être utile dans l'écriture scénaristique pour refaire le point. Mais moi aussi en fait je travaille comme ça, quand j'imagine un film, je vais très vite en incarnation. Donc quand j'écris des scènes de traitement, en vrai, elles sont assez précises et c’est souvent semi-dialogué. Et quand je dois passer d’abord par un traitement, c’est souvent un traitement assez développé et détaillé, voire un séquencier.
Mais donc là, avec Mikhaël, effectivement, il y a toujours eu une V1 où il a tout donné et où il y a déjà énormément d'éléments, le mouvement du film est là souvent. A partir de là, il me filait le bébé. C'est à dire que, à la fois il y a des choses encore à caler, à trouver d’un point de vue de « cuisine scénaristique », mais je pense qu'il a surtout envie que je casse un peu ce qu'il a mis en place.
ND : Qu’est-ce que tu entends par « casser » ?
MD : J’entends par là le fait de réinventer certains de ses personnages ou de ses scènes ou de ses fils narratifs d'une manière qui l'étonne ou qu'il n’aurait pas imaginé, ou que je l'amène sur un territoire de scènes ou de dialogues où il ne serait pas forcément allé. Que je le sorte d’un pré carré familier qui pourrait être trop confortable, s’il sent que c’est juste bien sûr et que ça résonne avec ses obsessions… De toute façon, à la fin, pour le scénario de tournage, et lors du tournage et du montage, c’est lui qui reprend la main… Et pas mal de choses peuvent être modifiées… Mais pour l’écriture, ça commence par de longues discussions où moi je lui explique comment je ressens et vois les choses, comment j'ai envie de repenser peut-être certains personnages, telles lignes etc… et j'ajuste le tir en fonction de là où ça répond, de là où ce n'est pas trop ça, de là où il le sent moyen mais il a quand même envie que j'essaie pour voir... Et à partir de là, je réécris, avec son vis-à-vis à lui. Je lui fais lire, il me fait des retours, partage ses interrogations, les endroits où ce n’est pas ça, on en discute puis je reprends le travail. Par exemple pour « Ce sentiment de l’été », dans la version qu'il avait proposée, on suivait le personnage qui perd sa compagne, joué par Anders Danielsen Lie, du début à la fin. Je trouve que la question du deuil, ce n'était pas une question facile à aborder. C'était vraiment très beau ce qu’il avait déjà proposé dans sa version, mais ce vers quoi on a réorienté le film, ce qui m'intéressait, c'était la manière dont le deuil peut avoir des conséquences inattendues et des répercussions sur tout l'entourage. J'avais très envie de faire ressortir le personnage de la sœur. Donc le fait que dans la deuxième partie, il soit ok pour qu’on essaie de basculer sur son point de vue, c'est vraiment quelque chose qui me motivait énormément dans cette écriture.
Ce qu’on voulait raconter c’est que quand il y a un décès – et notamment de quelqu'un de très jeune - dans ton entourage, ça peut te faire réagir aussi dans ta vie, te faire bouger alors que tu ne bougeais pas, il peut y avoir plein de conséquences inattendues. Pour moi, la sœur, c'est un peu le personnage secret du film. J'aime beaucoup le fait que, finalement, elle décide de changer de vie alors que pourtant elle a un compagnon sympa, un enfant… J'y crois très fort à ça, que des évènements extrêmement difficiles peuvent te faire réagir et te faire changer de vie. Et c'était ce fil-là, ces petites répercussions qu’on a suivies. Un film sur les parents, les amis, la sœur, comment ce décès contamine de manière qui peut être douloureuse, mais pas que, et parfois de façon inattendue donc, tout un entourage.

MD : Là je t'avoue que non, il n'y a pas eu vraiment de problèmes parce que le producteur Pierre Guyard, qui est arrivé au moment de la V2 que j’avais réécrite, a tout de suite accroché avec ça. Et puis, dans la deuxième partie, on passe sur la sœur, mais on retrouve quand même le compagnon et on garde donc sa problématique présente. Et je pense que ça amène justement comme une sorte de dispositif qui est un peu différent et un peu original, et qui en plus était motivé par ce qu'on voulait dire, qui n'était pas juste un dispositif formel « tape à l’œil ».
Par ailleurs, le fait de prendre des libertés avec le récit, c'est aussi quelque chose qui me motive quand je vais sur un projet. J’aime bien avoir une sorte de challenge dans l'écriture, quelque chose qui n'a pas été fait ou que je n'ai jamais fait. Parce que justement, en faisant un film sur le deuil, ce qui me posait question à la base, ce qui n'est pas facile, c'est que c'est un sujet extrêmement traité au cinéma. Et donc comment donner une vision qui est juste, qui est personnelle et qui est différente ? Et je pense que, justement, d'avoir géré les choses comme ça et d'avoir pris ce risque-là de changer de personnage, c'est une proposition, au contraire, qui pouvait séduire.
ND : Pour une autre histoire de deuil, je pense au film « Rien à foutre », du binôme de réalisateurs Julie Lecoustre et Emmanuel Marre, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ?
MD : Là, c'était très différent, mon intervention a été très ponctuelle. Ils avaient prévu une manière de tourner particulière, en deux sessions : ils avaient décidé de tourner, de s'arrêter, de monter, de réécrire et de retourner. Ils avaient donc déjà tourné 80% du film lors de cette première session. L’idée, c'était de repenser le film et de repartir en tournage à partir de là. Il se trouve que, au moment où ils ont entamé la deuxième session de tournage, le covid est arrivé et tout s'est arrêté. Il y a des choses qu’ils ne pouvaient plus tourner parce que ça se passait dans les lieux publics où tout le monde était masqué. D’autres qu’ils avaient tournées dont ils n’étaient pas complètement contents. Et à force d’être dans le film, il leur semblait manquer de recul. Á ce moment-là, ils ont fait appel à moi, je leur avais fait un retour sur leur scénario avant le tournage déjà. Ils avaient donc une version de montage que j'ai vue et que j'ai trouvée magnifique. Adèle était incroyable, il y avait des séquences folles… C'était vraiment un coup de cœur. Et l'idée c’était, pendant deux semaines de faire une session intensive avec eux devant le montage. Il y avait des noirs, des séquences qui manquaient, des choses comme ça, l’objectif du travail était de savoir à la fois où en était le film, qu'est-ce qu'il manquait, qu'est-ce qu'il fallait rééquilibrer, qu'est-ce qu'il fallait retourner et puis résoudre ce problème des scènes qu'il fallait complètement repenser parce qu'ils ne pouvaient plus les tourner. Donc le film était là, la trame avec le deuil dans la famille du personnage d’Adèle aussi. Mais il y avait des choses à repenser.
ND : Le monteur était présent ?
MD : Non, juste eux deux. C'était très intense, comme une partie de ping-pong en accéléré. C'était super, et puis vraiment, j'ai adoré ce qu'ils avaient tourné.
Il y a un cousinage avec Virgil Vernier je trouve. Le cinéma de Virgil est sans doute plus radical, mais il est très incarné aussi, et très vivant. Et même si les films peuvent contenir de la noirceur, il y a toujours de la drôlerie et de la tendresse. Je ne pourrais pas travailler sur un film où il n’y a pas d’humour et de vie. Impossible.
Et donc dans « Rien à foutre », il y a une pensée pas si éloignée, je trouve. Il y a une critique de la société, une critique politique, et la question c’était comment équilibrer ça, comment comprendre ce personnage qui est pris dans un système d’exploitation, qui en est aussi un des rouages, et faire que ça ne soit pas manichéen, complexifier le rapport aux choses. Il fallait travailler la question du deuil et comment il apparaissait, comment on garde l’empathie avec elle ou pas...
Dans leur film, comme dans le cinéma de Virgil Vernier, ce qui est intéressant c’est qu’ils montrent comment tu gardes des traces d'humanité, comment il y a des choses belles qui peuvent se passer dans un système que tu réprouves. Comment dans ce système-là, de transport aérien low-cost, qui est un peu une sorte de symbole de nos sociétés capitalistes, tu peux avoir une amitié ou un moment d'humanité, des éclats de beauté, qui restent. Mais qui font aussi que c'est ça qui t’emprisonne ou qui fait que tu ne vois pas où est le mal, comme si le mal n’était pas assez évident à identifier.
ND : Est-ce que cela t’arrive souvent de travailler sur les films à l’étape du montage ?
MD : Je suis pas mal intervenue sur le montage de « Tombé du ciel » de Wissam Charaf. Effectivement, il y avait encore des choses à chercher, à ajuster. Et là l'écriture a continué avec le monteur, William Laboury, Wissam et moi.
Sur les autres films, pas vraiment, à part quelques retours de montage bien sûr. En tant que scénariste, ça peut être un peu compliqué parce que c’est très chronophage et que si tu t'engouffres là-dedans, tu n’es pas rémunérée. Il faut pouvoir ouvrir du temps aussi, alors qu’on est en général déjà engagé sur d’autres projets.
Après je ne me propose pas forcément, car je pense aussi qu’à un moment le réalisateur doit se réapproprier le film, faire son truc. En tout cas, selon les besoins, il pourrait vraiment y avoir une place à penser pour les scénaristes à l’étape du montage.

ND : Comment tu choisis les projets sur lesquels tu travailles ?
MD : Je décide vraiment au coup de cœur. Les films que les cinéastes ont faits auparavant, c'est assez décisif notamment. J’ai besoin de savoir si leur univers, leur façon de filmer, me parle, si ça me touche ou pas. Il faut vraiment que je me sente une affinité avec la mise en scène et, aussi, que ça soit fluide avec la personne car l’écriture, c’est long !
Dans le projet lui-même, il faut aussi qu’il y ait quelque chose qui me parle. En général je sens tout de suite si « mon moulin à inspiration » se met à tourner ou pas.
Comme je l’ai dit, c’est primordial pour moi qu’il y ait de la drôlerie et de la vie, même si le tableau général dépeint est critique. Je crois d’ailleurs que j’ai de plus en plus besoin de comédie… comme de fiction… Une sorte de goût pour une narration ludique que je n’ai pas encore assez exploité. En ce sens, la co-écriture récemment de la mini série pour Erwan Le Duc a été un vrai plaisir… même si c’était dur aussi bien sûr. Là aussi, il y a le portrait d’un monde un peu fou et incompréhensible… !
Après, il y a des réalisateurs que j'aime mais sur tel projet je n’y vais pas, car je sens que ce n'est pas pour moi, il vaut mieux que ce soit avec quelqu'un d'autre. Ce n’est pas grave, même si on a déjà travaillé ensemble, on se retrouvera plus tard. Car en fait, c'est tellement dur d'écrire, c'est une telle implication, on vit complètement dans cet univers et donc si tu ne te sens pas en adéquation, je crois que ça ne va pas bien marcher. Tu vas souffrir… et le scénario aussi à priori ! Donc c’est vrai, je refuse même des projets dont je sais pourtant que ça va faire de beaux films. Mais juste ils n’étaient pas pour moi.
ND : Je trouve que c’est le signe d’une grande intégrité, ça veut dire que tu te connais vraiment bien toi-même !
MD : Je vais vraiment au feeling. Quand tu débutes, tu acceptes beaucoup de projets, et pour ma part j'ai pas mal souffert en acceptant des trucs qui en fait ne me correspondaient pas. Et je me suis dit que si je voulais perdurer dans ce métier, je ne pouvais pas faire ça, parce que j’allais me dégoûter de l’écriture. D’ailleurs la première chose que j’ai faite en sortant de la Fémis, c’est prendre un petit boulot, j’étais vendeuse dans une enseigne de surgelés. Ça me permettait de ne pas dépendre du scénario pour vivre et donc de pouvoir choisir. Je faisais aussi des fiches pour Canal + et le CNC, très formateur ! Après, on va pas se mentir, ça veut dire que je prends assez peu de projets, et que donc c’est très risqué financièrement…
ND : Allez, pour terminer, raconte-nous un peu comment tu as souffert !
MD : J'avais vraiment envie de me jeter par la fenêtre (rit). Par exemple j’ai dû travailler un mois sur un projet avant un dépôt… Un projet qui n’était pas vraiment mon truc mais que je pensais pouvoir aider à aboutir… Eh bien je comptais les jours. Un vrai compte à rebours. Et là je me suis dit, je ne vais pas tenir des années comme ça.
Donc en fait, ce n’est même pas une question de choix, je suis obligée de suivre mes intuitions.
Entretien mené par Nadja Dumouchel, scénariste membre du SCA, en janvier 2024.
Merci de citer le SCA-Scénaristes de Cinéma Associés pour toute reproduction
Ci-dessous, extrait des notes de travail de Mariette Désert